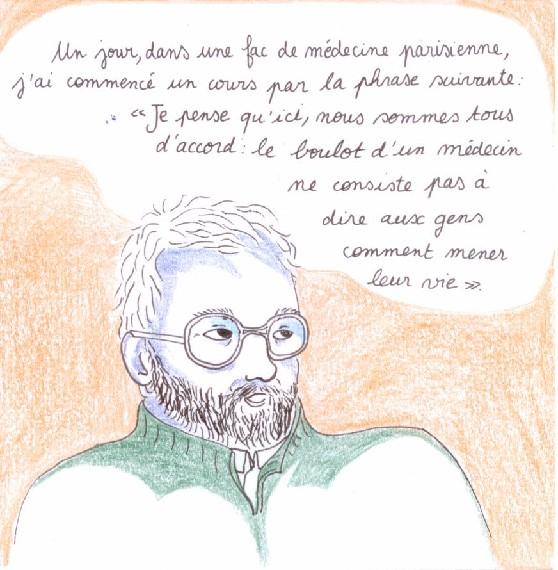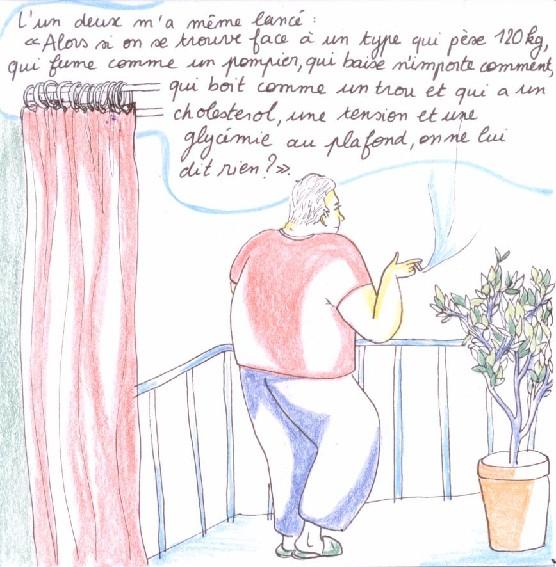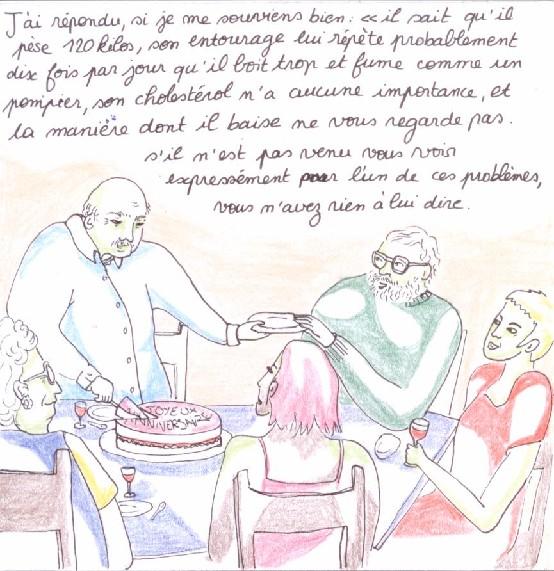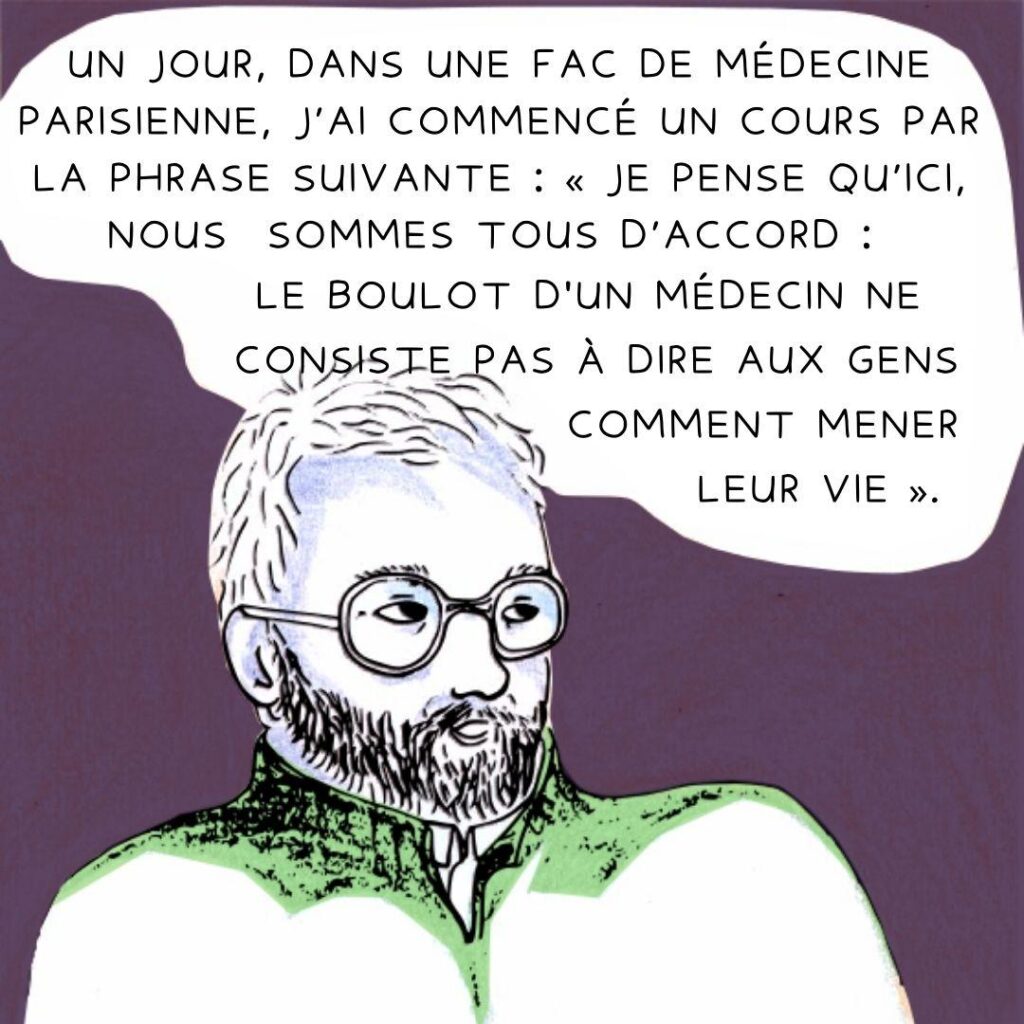Pourquoi la médecine échoue souvent à prendre soin de ses patients gros ?
Pour des raisons de lisibilité par toustes, certaines phrases de ce texte ont été rédigées au masculin. Ces phrases s’adressent cependant bien entendu à tout le monde.
Grossophobie (nom féminin) : ensemble des attitudes hostiles et discriminantes à l’égard des personnes en surpoids.
Cette discrimination s’insinue dans tous les aspects de la vie des personnes grosses (école, travail, transports, vêtements), mais particulièrement dans le domaine médical, où elles subissent le plus de violences.
Ces comportements ont pour cause des représentations culturelles négatives à l’égard des gros. Il existe des associations communément admise entre forte corpulence et défaut moraux : paresse, avarice, bêtise, impulsivité. Historiquement, ces associations viennent de l’Église, des cours princières et de la médecine qui continue à les diffuser en se focalisant uniquement sur les causes comportementales et individuelles de l’obésité.
La stigmatisation s’abat avec d’autant plus de violence sur les femmes, pour qui l’injonction à la minceur est beaucoup plus forte.
Nous assistons à un glissement du dénigrement de la grosseur pour des causes morales (toujours très présent même si il est assez critiqué) vers la condamnation de l’obésité pour des raisons sanitaires. L’institution médicale joue donc un rôle clé dans la grossophobie ordinaire.
Le problème de ces conceptions est qu’elles abordent l’obésité comme étant uniquement le résultat de mauvais choix alimentaires et d’un manque d’exercice physique dont l’individu serait complètement responsable.
Or les causes de l’obésité sont nombreuses et complexes : causes psychologiques (des traumatismes dans l’enfance sont liés à l’apparition de TCA comme la boulimie ou l’hyperphagie boulimique), biologiques (certains gènes sont associés à un risque élevé de développer une obésité), et surtout structurelles (sociale et environnementale).
L’explosion du nombres d’obèses dans les pays développés et en développement les dernières décennies montre que l’obésité est un problème collectif, et non individuel, lié à la réorganisation de nos sociétés modernes.
Sa prévalence significativement différente selon les groupes sociaux prouve qu’il s’agit d’un enjeu social. A la fois parce que des facteurs sociaux, comme la précarité, jouent un rôle dans le développement de l’obésité, et parce que cette dernière peut avoir un impact fort sur la trajectoire sociale de l’individu.
La grossophobie médicale
Les personnes grosses rencontrent souvent de grandes difficultés à se faire soigner correctement. D’abord à cause d’un manque de matériel adapté : tables d’examen trop étroites, fauteuils à accoudoir, brassards trop petit, IRM limité à 150 kg… Ce sont aussi une inadaptation des dosages de certains médicaments, notamment les substances lipophiles, qui n’auront pas la même efficacité. L’obésité est considérée par l’OMS non seulement comme une maladie mais comme une épidémie mondiale, on peut donc s’attendre à voir de nombreux obèses à l’hôpital ou dans nos cabinets. Comment se fait-il alors que nous n’ayons pas le matériel nécessaire pour les accueillir ?
La grossophobie médicale, c’est surtout la maltraitance des personnes grosses par les professionnels de santé. De nombreux témoignages rapportent des commentaires déplacés, une attitude paternaliste voir humiliante. Mais qu’est–ce qui explique ces difficultés du corps médical à prendre soin des gros ?
Tout d’abord, les soignant.es sont des gens comme les autres, baignés dans une culture grossophobe, sauf que dans le monde médical, ces biais sont encore plus marqués et appuyés par l’autorité médicale.
L’insistance du corps soignant à faire remarquer à leurs patients qu’ils sont gros vient sans doute souvent d’une volonté de bien faire ; on nous apprend que l’obésité est mauvaise pour la santé, on veut le meilleur pour nos patients, il serait donc de notre devoir de les informer que leur surpoids met leur santé en danger, quitte à être durs avec eux. Pavée de bonne intentions, cette démarche échoue pour plusieurs raisons. D’abord, les obèses savent qu’ils le sont, et ils savent que c’est mauvais pour la santé, le monde entier le leur rappelle en permanence. De plus, stigmatiser les gros ne les fait pas maigrir, bien au contraire. Peut–être vaudrait–il mieux demander à nos patients si leur poids est une question qu’ils souhaitent aborder avant de leur prescrire une consultation diététique.
En médecine, le surpoids et l’obésité sont considérés comme un facteur de risque modifiable de nombreuses maladies chroniques. Ce prisme sur le surpoids, bien que pas complètement faux, est restrictif et à l’origine d’une grande frustration pour ceux qui dédient leur vie à assurer la santé des autres. Pourtant, on peut être obèse et en bonne santé ; en effet certaines études ont montré que c’est la graisse abdominale qui est associée à des risques accrus de maladies chroniques. Or toutes les personnes médicalement obèses (dont l’IMC est supérieur à 30) ne stockent pas au niveau abdominal et la perte de poids, nous y viendrons plus tard, présente ses propres risques.
Ensuite, marqués par l’idée que les obèses le sont par manque de volonté, les médecins ont aussi tendance à croire que leurs patients obèses sont moins susceptibles de prendre correctement leur traitement, ce qui peut gravement nuire à la relation soignant soigné.
Enfin, il existe clairement un mépris des gros, surtout venant des médecins. Et pour cause, l’obésité est un marqueur de précarité et de déclassement social : venant de médecins, le mépris des gros est aussi un classique mépris de classe.
Cette maltraitance passe aussi par une négligence involontaire des soignant.e.s trop focalisés sur le poids de leur patient.e.s. Énormément de personnes grosses témoignent avoir vécu des erreurs de diagnostic par un médecin qui expliquaient tous leurs maux par leur surpoids sans pratiquer d’examen clinique rigoureux pour vérifier leur hypothèse. Cette négligence peut avoir des conséquences graves, comme la découverte tardive d’un cancer qui aurait pu être dépisté dès les premiers symptômes.
De nombreuses femmes racontent aussi s’être vues refuser la prescription de la pilule, ou la pose d’un stérilet, refus plus ou moins explicitement motivé par la croyance que les grosses ne peuvent pas ou ne devraient pas avoir de sexualité.
Pour les grossesses c’est pareil, beaucoup de femmes grosses entendent qu’elles ne pourront jamais tomber enceinte à cause de leur poids, annonce délivrée sans aucun tact et qui s’avère souvent fausse. Et une fois qu’elles sont enceintes, les gynécologues s’empressent de leur prédire les pires catastrophe, du diabète gestationnel à l’éclampsie en passant par le macrosome.
Bref, la gynécologie est une spécialité incontournable lorsqu’on parle de grossophobie médicale.
Il n’existe malheureusement pas d’étude sur ce thème, mais les témoignages accablants s’accumulent.
A force de discours moralisateurs et de mauvais traitements, de nombreuses personnes obèses développent une appréhension justifiée du milieu médical, ce qui les met en danger et réduit encore plus leur accès au soin.
Souvent teintée de bonnes intentions, la stigmatisation des gros a non seulement des conséquences délétères sur leur bien–être et leur trajectoire sociale, mais elle est aussi contre-productive. On ne le dira jamais assez, culpabiliser et stigmatiser un gros ne l’aidera pas à mincir !!! Bien au contraire, la stigmatisation est liée à une aggravation de l’obésité.
Nous sommes donc face à une situation où les obèses sont moins bien soignés que les autres (alors qu’ils sont supposément malades), et se voient sans arrêt conseiller de perdre du poids par les professionnels de santé. Mais quelles solutions pour maigrir ?
Les fausses routes de la minceur
Les produits, services et programmes minceur représentent une véritable industrie promue à coup de publicité omniprésente. Et ça ne s’adresse pas qu’aux personnes en surpoids, tout le monde peut chercher à s’amincir! La publicité agressive de cette industrie profite et participe à un véritable culte de la minceur.
En ce moment, l’industrie se détourne des régimes, très critiqués, pour aller vers le coaching, le fitness, les rééquilibrages alimentaires (qui sont souvent des régimes déguisés), les compléments alimentaires, aliments miracles et tout une panoplie de pratiques de soins et de bien-être à visée amincissante. Les méthodes pour mincir se multiplient sur le marché, rapportant environ 2,5 milliards d’euro par ans. Le secret de leur rentabilité ? Les complexes et la culpabilité de leur consommateurices (surtout des femmes) qu’ils participent largement à développer. Et leur inefficacité, puisque si ces produits permettaient réellement de perdre du poids définitivement, on en aurait besoin que d’une seule fois dans sa vie. Les marché de la minceur est un excellent exemple de logique marchande allant complétement à l’encontre des intérêts des potentiel.le consommateurices, le but est de vendre et donc de reproduire le plus possible, voir de créer le besoin.
Certains auront tendance à s’en remettre à leur médecin pour se délester de leurs kilos jugés superflus ; les personnes en surpoids n’auront parfois même pas à formuler la demande que leur médecins leur proposera déjà une méthode d’amincissement.
La première réponse des médecins face au surpoids est le régime restrictif : selon les études, entre 50 et 98% des médecins le proposent à leurs patients en surpoids. Pourtant, cette solution n’est ni sans risques ni très efficace sur le long terme : 80 % des sujets on repris le poids perdu au bout d’un an (et ce taux augmente à long terme). Beaucoup de personnes mises au régime font l’expérience des effets vicieux de la restriction cognitive : l’intellectualisation et la restriction de l’alimentation mène à une augmentation paradoxale de la consommation alimentaire à long terme.
C’est ce qui est responsable du fameux effet yo-yo, des pertes de poids suivies de reprises majorées de quelques kilos, à l’origine du surpoids de certaines personnes qui ont commencé un régime alors que leur IMC était dans la norme. La pratique du régime peut donc mener à des fluctuations pondérales importantes qui sont associés à des risques accrus de maladies cardio-vasculaires. Mais en eux-mêmes, les régimes, surtout les plus drastiques, présentent de nombreux risques psychologiques, comportementaux (développement de troubles du comportement alimentaire notamment) et physiologiques (par déséquilibre nutritionnel). Et même sans augmentation excessive de la prise alimentaire après le régime, on risque de reprendre du poids à cause de l’adaptation du métabolisme basale suite à une restriction calorique trop forte et prolongée.
Avec la volonté de faire maigrir les obèses à tout prix, ou à la demande de leurs patients, de nombreux médecins se sont tournés vers des solutions pharmacologiques. La liste des coupe-faim retirés du marché car ils représentaient des risques trop importants, est longue : le médiator dont on a beaucoup entendu parler vient tout de suite en tête, mais aussi ses 2 grands frères issus du même laboratoire et de la même recherche : le pondéral et l’isoméride. On peut aussi citer l’Acomplia, retiré en 2006, le Sibutral retiré en 2010, et plus récemment le Bodygoal (2022). Et la course à la recherche d’une molécule amincissante est toujours en marche.
A des stades avancés de l’obésité, il devient très difficile de significativement perdre du poids sans chirurgie bariatrique. Les méthodes de chirurgie bariatrique sont développées depuis les années 1950 ; elles consistent toutes en une modification anatomique du tube digestif qui restreint la consommation alimentaire et provoque une malabsorption des aliments ingérés. L’anneau gastrique, la sleeve et le by pass sont les plus pratiquées. Elles sont indiquées pour les personnes ayant un IMC supérieur à 40kg/m² ou celle avec un IMC supérieur à 35kg/m² avec des comorbidités. En France, 60 000 personnes sont opérées tous les ans. Avec un coût de 500 à 1500€ l’intervention remboursée par l’assurance maladie à l’hôpital public, et jusqu’à 25 000€ en clinique privée, la chirurgie est un marché très lucratif.
Mais qu’en est–il de son efficacité ?
De nombreuses personnes sont très satisfaites de s’être fait opérer, et ne rencontrent pas de conséquences négatives majeures. Il y aurait une chute de la mortalité de 29 à 50 % dans les années qui suivent l’opération. Aurions nous donc trouvé la solution miracle ? Pas vraiment.
Les risques sont importants. La chirurgie bariatrique empêche les personne de s’alimenter normalement, ce qui a un fort impact sur la vie sociale. Les patients rencontrent souvent des difficultés à se réapproprier leur corps et sensations après la perte de poids brutale. Les conséquences psychologiques sont fréquentes suite à l’opération : dépression, tentatives de suicides, développement de nouvelles addictions… C’est pourquoi le suivi psychologique est recommandé, malheureusement, il n’est pas toujours remboursé.
De plus, son efficacité à long terme est controversé : malgré une rapide perte de poids, il y aurait 20 à 30 % d’échec de perte de poids à 10 ans de l’opération.
Une partie des échecs et des conséquences négatives de la chirurgie est liée au non respect des recommandation de l’HAS de ne pas pratiquer de chirurgie bariatrique sur des patients souffrant d’un trouble du comportement alimentaire, et au manque de suivi médical et psychologique rigoureux après l’opération.
En plus de ces risques, la malabsorption alimentaire provoquée mène à des carences graves en vitamines. La supplémentation vitaminique est strictement nécessaire à vie pour éviter des situations très graves et pouvant mener à de très lourdes séquelles (encéphalopathie de Gayet Wernicke ou polyradiculonévrite aiguë).
Or les vitamines ne sont pas remboursées par la sécurité sociale : le coût mensuel est d’environs 50 euros pour une supplémentation vitaminique et nutritionnelle correcte (vit B1, B9, B12, fer et calcium).
Entre les suivis psychologique, nutritionnel et les suppléments vitaminiques obligatoires à vie, les suites d’une chirurgie bariatrique représentent une forte contrainte économique alors que la population à laquelle elle s’adresse, les obèses morbides, sont plus nombreux dans les classes populaires et les plus précaires.
La lutte acharnée contre l’obésité est justifiée par des raisons de santé mais les méthodes d’amincissement sont souvent prescrites au mépris total de la santé des individus.
L’obésité est de plus en plus courante, représentant des dépenses de santé importantes, et la médecine n’est pas en mesure d’y apporter de solution individuelle fiable. La question de l’obésité est donc devenue une grande question de santé publique . Si on ne peut pas la «guérir», il faudrait donc absolument prévenir l’obésité.
Depuis plusieurs dizaines années, les plans de prévention se multiplient, cherchant à inculquer les bonnes pratiques alimentaires et sportives aux populations visées. Les études d’impact sont rares, et celles qui ont été menées apportent très peu de preuves de leur efficacité.
L’approche qui consiste à diffuser au grand public des connaissances nutritionnelles et des recommandations médicales sont inefficaces car elles ignorent les enjeux sociaux et psychologiques essentiels pour comprendre les comportements alimentaires. En plus de cela la médicalisation de l’alimentation peut nuire au rapport à la nourriture de nombreuses personnes, en surpoids ou non. Nous y reviendrons, mais tenter de contrôler drastiquement son alimentation pour la faire adhérer à des règles strictes sous prétexte qu’elles sont scientifiques conduit à une aliénation à son propre corps et peut avoir des effets contre-productifs.
Enfin, ces campagnes renforcent l’idée que mincir ou rester mince est uniquement une question de choix personnel et de motivation ce qui aggrave la stigmatisation des gros.
Peut–être l’échec de la prévention de l’obésité vient-elle de son renoncement à agir sur les causes structurelles de l’obésité.
Les causes structurelles de l’obésité
La hausse rapide la prévalence de l’obésité est souvent expliquée par une augmentation de notre consommation alimentaire et une diminution de nos dépenses énergétiques.
Avant le développement de l’agriculture moderne, il était avantageux pour les humains de stocker de l’énergie sous forme de graisses pour survivre aux futures famines potentielles ; c’est un trait génétique qui s’est rependu, particulièrement dans certaines populations (en Polynésie notamment). La rationalisation moderne de l’agriculture a mis fin aux situations de famine dans certaines parties du monde, cette sécurité alimentaire souhaitable provoque l’obésité de ceux qui y sont génétiquement prédisposés.
Plus important encore, l’industrie agro-alimentaire et sa logique capitaliste ont pour objectif de vendre toujours plus à une population stable démographiquement. Pour cela, elle a dû s’adapter en misant lourdement sur le marketing, l’augmentation des portions et sur les aliments gras, salés et sucrés, sans grande valeur nutritionnelle, qui incite à consommer plus. La publicité est particulièrement agressive envers les publics jeunes, voire très jeunes, à la fois parce que les enfants sont un publique très réceptif et parce qu’une fois qu’un individu est habitué à certains produits, il est susceptible d’y revenir toute sa vie.
Si on se questionne sur l’efficacité du marketing, il suffit de regarder combien cette industrie dépense en publicité (4,5 milliards d’euro en 2016, ce qui représentait la moitié de ce qui a été dépensé en pub toutes industries confondues).
L’industrie agro-alimentaire étant très adaptable, elle a vite réalisé que les tentatives de perte de poids pouvaient représenter un marchés très lucratif. Ainsi, un même groupe peut vendre des produits transformés incitant à la surconsommation, et des yaourts 0 % et des barres de céréales sans sucre.
Pour ce qui est de nos dépenses énergétiques, la sédentarité est monnaie courante dans une société urbanisée, organisée autour de la voiture, avec un monde du travail largement tertiarisé. Néanmoins, tout le monde n’est pas devenu obèse. Ceci s’explique à la fois par des prédispositions génétiques et par des facteurs sociaux. Car ce qui favorise fortement l’obésité, c’est la libéralisation du marché du travail. Plus les employeurs sont en mesure de faire travailler des gens dans des conditions précaires (bas salaires et horaires déstructurées) plus la différence de prévalence de l’obésité entre les classes sociales se creuse. Car s’alimenter sainement et faire du sport n’est pas qu’une question de connaissances et de volonté, il s’agit aussi de réunir les conditions matérielles pour le faire (ressources financières suffisantes pour acheter des produits frais, temps pour les cuisiner, faire ses courses, faire du sport). Récemment l’inflation a d’autant plus creusé l’inégalité d’accès à une alimentation complète.
Il existe un culte de l’apparence et de la minceur qui touche principalement les femmes. Ces dernières sont systématiquement renvoyées à leur image, dont leur valeur dépendrait. Cette situation mène de nombreuses femmes à sur-conscientiser leur alimentation, dans une volonté de gestion rationnelle de leur corps ce qui créé une forme d’aliénation à son propre corps. Cette logique managériale a pour conséquence des comportements de compensation, jusqu’aux troubles du comportement alimentaire dont la boulimie ou l’hyperphagie boulimique.
En plus de cela, l’alimentation est actuellement une source de tabou : révéler ce que l’on mange quand cela ne correspond pas à ce que l’on pense qu’il est bien de manger est plus honteux que jamais. La nourriture est l’objet d’un certain nombre de codes culturels fortement liés à l’identité personnelle. Nous sommes donc dans un jugement permanent de ce que l’on mange ce qui aggrave l’intellectualisation de l’alimentation.
Ces éléments participent à une destructuration de l’alimentation. Là où l’alimentation était auparavant régulée par des codes culturels forts (ce que l’on mangeait, quand et comment, « allait de soi »), nos choix alimentaires sont maintenant très conscientisés, liés à la morale et à l’image de soi.
Critique du body positive
Le thème de la grossophobie a principalement été abordé dans le mouvement du body-positive et dans des courants féministes et intersectionnels.
Le body-positive est un mouvement massivement présent sur Instagram, qui encourage l’amour de soi et de son corps et prône la représentation des corps qu’on ne voit jamais : obèses, en fauteuil ou amputés ect…. Il a eu un réel impact positif pour l’image de soi et donc la santé mentale de nombreuses personnes (surtout des femmes). La représentation de corps qui sortent de la norme est un bon moyen de contrer les effets du matraquage médiatique et publicitaire des standards de beauté, particulièrement redoutables chez les jeunes filles. Aussi, pouvoir échanger avec d’autres personnes grosses, avoir accès à leurs témoignages permet de remettre en question la grossophobie intériorisée particulièrement nocive lorsqu’on est soi-même gros.se.
Le potentiel émancipateur de ce mouvement a tout de même ses limites. Puisqu’il est né sur Instagram, il est centré sur l’image, et bien que son intention de nous libérer des normes esthétiques, il ne peut pas nous aider à nous détacher de l’obsession de notre image. Bien qu’il est important pour son estime de soi de pouvoir se trouver beau/belle, notre société moderne y accorde une importance étouffante (encore une fois, surtout pour les femmes). Aimer son image à tout prix et malgré les standards de beauté peut être ressentie comme une nouvelle injonction, plus que comme une libération.
De plus, certains de ces discours sur la grossophobie rejettent en bloc les liens entre obésité et problème de santé et condamne toute tentative de contrôle du poids. Bien que la conception de l’obésité comme une maladie en elle-même est questionnable, nier son impact sur la santé, en particulier celui de l’obésité morbide est un périlleux exercice de mauvaise foi.
Lutter contre la grossophobie, ce n’est pas faire la promotion de l’obésité, ni se complaire dans une positivité superficielle qui chercherait à nier le danger que l’obésité peut représenter pour la santé.
C’est chercher à adopter une approche non stigmatisante, de considérer un individu en entier et ne pas laisser une seule caractéristique, comme le poids, masquer tout le reste. C’est cesser d’objectiver les personnes grosses et les considérer réellement comme des sujets.
Conclusion
L’obésité est à la fois un problème médical et politique. L’épidémie d’obésité est un des signes que le capitalisme arrive à ses limites et une preuve que cette logique ne sert qu’à enrichir une minorité aux dépends de la qualité de vie, de la santé et de l’émancipation de la vaste majorité.
La sphère politique est démunie car les éléments qu’elle pourrait faire évoluer dans la bonne direction vont à l’encontre de la logique capitaliste qu’elle protège par ailleurs. Face à cette impuissance, sa seule « solution » est de faire de la prévention et de médicaliser la question.
La lecture purement médicale, centrée sur l’individu, sa biologie et son comportement personnel échoue à analyser les causes plus larges, collectives, de l’obésité, comme en témoigne le manque d’efficacité de l’acharnement des médecins et des politiques publiques à faire maigrir les obèses. Faire peser sur le corps médical toute la responsabilité de la gestion d’une « épidémie mondiale » ne pourrait-il pas participer à pousser les professionnels de santé à malmener leurs patients gros?
Comment peut on lutter efficacement contre l’obésité et ses conséquences délétères sans passer par une action politique de lutte pour changer l’organisation de nos sociétés ?
Contre la grossophobie qui aggrave et enferme les personnes dans l’obésité. Pour l’émancipation des femmes, chez qui l’obésité causée par des TCA est significativement plus fréquente, effet de l’écrasante injonction à la minceur qui pèse sur elles et de la considération de la forme de leur corps comme mesure de leur valeur. Contre la précarité et le marché du travail libéral. Contre la logique capitaliste de l’industrie agro-alimentaire et par conséquent contre la propriété privée des moyens de production, l’exploitation et la logique marchande qui sont les piliers du mode de production capitaliste.
Comment peut on remédier à des maladies largement favorisées par un capitalisme qui ne peut que s’intensifier, avec des campagnes de prévention et des conseils diététiques?
Sources :
– Gros n’est pas un gros mot de Daria Marx et Eva Perez-Bello
– Grossophobie, sociologie d’une discrimination invisible de Solenne Caroff
– Sociologie de l’obésité de Jean Pierre Poulain
– Les métamorphoses du gras de Georges Vigarello
– Le médecin, le patient et les kilos en trop de Martin Winckler
– Impact of weight bias and stigma on quality of care and outcomes for patients with obesity. Phelan SM, Burgess DJ, Yeazel MW, Hellerstedt WL, Griffin JM, van Ryn M.
– Impact of weight bias and stigma on quality of care and outcomes for patients with obesity. Phelan SM, Burgess DJ, Yeazel MW, Hellerstedt WL, Griffin JM, van Ryn M.
– The stigma of obesity, a review and update, de Rebecca M. Puhl et Chelsea A. Heuer
– La restriction cognitive ou comment les régimes font grossir de Marine Parrot